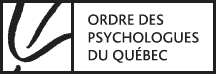Nicolas Lévesque : L’intellectuel public

Psychanalyste, écrivain et éditeur, le psychologue Nicolas Lévesque plaide pour une révolution non utopique où le sacré aurait sa place au même titre que l’économie. Fils d’un ancien dominicain qui fut le premier à enseigner Lacan au Québec, il porte en lui l’humanisme des valeurs chrétiennes et un immense respect pour le savoir des vieux philosophes.
Durant son stage à l’hôpital Saint-Luc à la fin des années 1990, Nicolas Lévesque flânait régulièrement dans Chinatown en quête d’un sandwich ou tout simplement pour se perdre parmi les étals de légumes et de fruits exotiques.
Au cours de ces moments arrachés au quotidien, il lui arrivait de s’interroger sur lui-même : était-il un patient ou un psychanalyste ? Un homme du peuple ou un membre d’une élite spécialisée ? Un écrivain en devenir ou un futur praticien ?
Vingt-cinq ans plus tard, le Dr Nicolas Lévesque est parvenu à conjuguer tous ces possibles. À 42 ans, il fait partie, selon ses propres termes, de ces « oiseaux rares qui mélangent la psychanalyse, la littérature, la déconstruction, la politique et l’économie ».
Il faut un village
Psychanalyste, écrivain et éditeur, il pratique sa profession en cabinet privé depuis 1998. Homme de culture, il cite volontiers Marx, Derrida, Nietzsche et… Pink Floyd dans ses textes. Il est l’auteur de six ouvrages, notamment Ce que dit l’écorce, un essai coécrit avec Catherine Mavrikakis qui lui a valu une nomination aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada en 2015. Il collabore aussi régulièrement au magazine Spirale. Et à compter de septembre, à la tête du Groupe Nota Bene, il consacrera trois jours par semaine à ses fonctions d’éditeur.
« Ce que j’aime le plus dans ma pratique, observe-t-il, c’est le côté médecin de village. Un être fait de longues études, il se cultive, ouvre un bureau et met son bagage au service de qui le veut bien. » Mais la déshumanisation fait rage et le village est cerné de toute part. Nicolas Lévesque résume la situation : « La psychanalyse est en train de mourir. Face au modèle scientifique, la tradition humaniste de notre profession peine à survivre. On ne parle plus que de diagnostics, de troubles de la personnalité, de tests, de critères d’efficacité. C’est un détournement de notre mission, carrément. »
Il observe le même reflexe comptable à l’université, où les défenseurs de la philosophie humaniste ont pris leur retraite et n’ont pas été remplacés. « Partout, la tendance scientifique domine. Les subventions sont accordées selon des critères mesurables. La vision de l’être humain se définit en termes quantifiables. La culture de l’argent règne en maître. »
L’intellectuel public
Le Dr Lévesque a reçu la psychanalyse en héritage. Son père, un éminent philosophe, a été le premier à enseigner Lacan et Freud à l’Université de Montréal.
Figurant parmi les penseurs de la Révolution tranquille, Claude Lévesque était un ancien dominicain. Il avait étudié à Paris. Il fréquentait les automatistes. « Durant les années 1950, rappelle son fils, tout le monde se mélangeait. Peu importait ce que tu faisais dans la vie. Un projet de société, ça se défend comme ça. Embarques-tu ou pas ? »
Comme psychologue, Nicolas Lévesque revendique un rôle d’intellectuel public, apte à penser les enjeux qui secouent notre planète. Mais il ne se sent pas le bienvenu dans la sphère médiatique. « Au Québec, les psys comme moi sont un peu vus comme des charlatans. Les gens se disent : “Ouais, ouais, l’inconscient…” »
S’il est devenu éditeur, c’est justement pour pouvoir s’exprimer librement. « En dehors de la sphère littéraire, il n’existe aucune plateforme pour moi », tranche-t-il.
Notre héritage le plus précieux
À son avis, le malaise qu’il ressent est généralisé, touchant un bon nombre de collègues. « Je reçois en clinique plusieurs jeunes psys qui ne se reconnaissent pas dans l’approche scientifique de la profession, qui réduit tout en quantités mesurables. Ces jeunes cherchent une transcendance et ils ne la trouvent nulle part. Il existe des échappatoires, mais tout le monde ne peut pas se lancer en littérature. »
Mais pourquoi protéger la psychanalyse si la science se montre plus prompte à soulager la souffrance ? « D’abord, résume- t-il, il y a des limites à ce que peuvent accomplir les diagnostics et les médicaments. Ensuite, il n’y a que la psychanalyse pour empêcher les compagnies d’assurance, les gestionnaires et les autres acteurs du système de santé de redéfinir la profession [de psychologue] à l’heure actuelle. »
La psychanalyse fait également partie de notre héritage le plus précieux, plaide-t-il, « au même titre que la littérature, la peinture ou la philosophie ».
Une quête de sens
Souverainiste, Nicolas Lévesque se désole de constater que « le boire et le manger soient devenus notre principal liant social ». À son avis, aucun projet politique digne de ce nom ne pourra voir le jour s’il n’est pas porté par une quête de sens. « N’est-ce pas le défi de tous les pays laïques ? Retrouver le sacré après les religions ? »
Optimiste presque malgré lui, il en appelle à une « révolution non utopiste », où le Québec passerait enfin à l’âge adulte. Au Parti québécois, on se méfie de lui. On le trouve vaseux. Il n’en a cure. « Ça prend des psys pour servir la société d’aujourd’hui, expliquer nos névroses personnelles et collectives. Ça prend des psys pour rappeler qu’il n’y a pas de solution simple, pour rappeler que le plus important, c’est de s’abandonner à l’idée qu’on ne sait rien. »
Tomber en morceaux
Il lui arrive de « tomber en morceaux ». Psychiquement, intellectuellement et existentiellement. « Je sais trop bien ne pas exister », confiait-il récemment à un ami. La phrase ornera la couverture de son prochain livre. L’ouvrage paraîtra cet automne aux éditions Varia, dans la collection « Proses de combat ». « Ça porte sur mon histoire personnelle mais aussi sur l’histoire du Québec, son destin, et plus largement sur le monde dans lequel on vit. »
L’homme s’est toujours méfié des clichés de la psychanalyse. « Je ne pense pas que ce soit Freud qu’il faut sauver, ni même l’inconscient ou sa vision de la sexualité. Non, ce qui est en jeu, c’est l’espace pour créer, à l’intérieur duquel on trouve le temps pour pleurer, pour rêver, pour penser. »
Doté d’« une capacité anormale à porter le refoulé des autres », il affirme se prendre parfois pour un « sauveur » — une condition qu’il fait remonter à son histoire familiale, au passé d’orpheline de sa mère, à l’éducation qu’il a reçue. « J’ai étudié chez les Jésuites. À 14 ans, j’étais moniteur dans un camp pour jeunes défavorisés. À 16 ans, je faisais la cuisine pour les 80 personnes du camp. Je suis marqué par mon bagage chrétien. »
Il dit aussi se trouver meilleur psychanalyste depuis qu’il a des enfants. « C’est un travail où l’on mûrit avec l’âge », notet- il. Il voit néanmoins des limites à l’idéologie du vécu. « Je n’ai pas besoin d’être cocaïnomane pour comprendre les problèmes de dépendance. »
Dans sa salle d’attente, on trouve des punks, des comédiens au chômage, des jeunes psys, des gens âgés, des écrivains. « Que ce soit parce qu’ils projettent de louer un atelier ou parce qu’ils souhaitent faire le tour du monde, les gens font la révolution tout le temps dans mon bureau. Au fond, ils ont juste besoin d’un espace pour entretenir cette vision suffisamment longtemps pour que ça marche. »
Il aime ce métier de passions et de mots. En ces temps de grands tourments, il envisage le psychologue comme un allumeur de réverbères, « semblable à une sculpture de Rodin dans un parc ou au coup de crayon de Toulouse-Lautrec, véritable pont entre les beaux-arts et la rue ».

Par
Hélène de Billy | Rédactrice pigiste