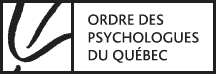Rencontres avec trois psychologues engagés dans le processus de guérison des Premières Nations
Hélène de Billy | Rédactrice pigiste
Suzy Goodleaf | Psychologue

On discute beaucoup de choix scolaires dans le bureau de la psychologue Suzy Goodleaf, à Kahnawake. Très souvent, les parents hésitent entre l’école bilingue, l’immersion totale en mohawk, les cursus en français ou en anglais. « Les gens sont déchirés, constate Mme Goodleaf. Bien sûr, ils désirent tous un avenir prometteur pour leur enfant. Mais ils souhaitent également préserver leur identité. »
Spécialiste de la thérapie familiale, détentrice d’un baccalauréat en psychologie de l’Université Concordia et d’une maîtrise en éducation de l’Université McGill, Suzy Goodleaf appartient à la nation mohawk comme la majorité de ses clients. Elle est née à Brooklyn, dans un quartier appelé alors « Little-Caughnawaga » (le nom anglais de Kahnawake). Comme plusieurs Mohawks de sa génération, son père s’était rendu à New York pour travailler comme monteur de charpentes en acier sur les chantiers de construction. « Mon père a subi un accident sur le chantier de Penn Station et il s’est brisé le dos. J’avais trois ans. La famille est revenue à Kahnawake. »
Ce qui l’a poussée à entreprendre une formation en psychologie? « J’ai toujours voulu comprendre l’être humain. Et puis, j’ai connu des difficultés. Des psychologues m’ont aidée. J’ai commencé à détecter l’aspect multigénérationnel inhérent à ma souffrance et à saisir pourquoi j’étais tombée dans les drogues et l’alcool. »
Société matriarcale, la nation mohawk revendique le pouvoir pour les femmes. « Au fil du temps, ça s’est un peu perdu, regrette Mme Goodleaf. Mais ce n’est pas une légende. Mes grands-mères étaient très fortes. Quand elles prenaient une décision, celle-ci avait force de loi. Parfois, je me demande jusqu’à quel point les Premières Nations n’ont pas influencé la société québécoise à cet égard. »
Dans son bureau, sur une petite table, on trouve quelques éléments de la médecine traditionnelle des Premières Nations : plumes d’aigles, vases pour les offrandes de tabac, collier de wampum et autres plantes médicinales destinées à apaiser et à promouvoir la réflexion. Elle porte également un bijou à son cou où sont évoqués les quatre points cardinaux, qui évoquent à leur tour les quatre saisons. « Nos traditions nous enseignent que la souffrance est une forme d’apprentissage, un moyen de grandir », rappelle la psychologue.
Membre de l’Ordre depuis 1993, Suzy Goodleaf utilise tous les outils à sa disposition, autant ceux issus du savoir ancestral que les théories apprises sur les bancs de l’université. Mais ses clients ne font pas tous preuve de la même ouverture aux traditions. Chez les aînés, par exemple, plusieurs parlent la langue des Anciens, mais ont abandonné les rites de leurs ancêtres pour la pratique des religions chrétiennes. Chez les jeunes, c’est l’inverse. On ne parle plus la langue, mais on renoue avec les vieilles cérémonies. Elle cite le cas de sa mère, qui s’est rendue à Rome pour la canonisation de Kateri Tekakwitha, en 2012. « Comme psychologue, je dois rencontrer les gens là où ils se trouvent, dit Suzy Goodleaf. Plusieurs de mes clients sont très catholiques. Il est bien évident que je respecte ça. »
Consultante auprès de la Commission de vérité et réconciliation instituée en 2008 par le gouvernement fédéral pour faire la lumière sur la réalité des « pensionnats indiens », Suzy Goodleaf a participé à plusieurs rencontres avec les survivants de ce qui a finalement été qualifié de génocide culturel par les autorités canadiennes.
De part et d’autre, on commence seulement à comprendre les effets de la colonisation sur les Premières Nations. Chez les non-autochtones qu’elle côtoie, Suzy constate une certaine incompréhension quand ce n’est pas de la colère ou de la culpabilité. Inutile de vous excuser, dit-elle en s’adressant aux psychologues qui ne sont pas issus des Premières Nations. Nous commençons seulement à comprendre les effets de la colonisation. Un peu d’humilité suffira. « Admettez que vous ne savez pas tout », résume-t-elle.
L’oppression culturelle des Premières Nations a contribué à l’existence de problèmes sociaux qui continuent d’affecter de nombreuses communautés aujourd’hui. Suicides, accidents violents, toxicomanie : à Kahnawake, les tragédies ont afflué au cours de l’hiver. « Parmi les funérailles, il faut choisir celles auxquelles on va assister », laisse tomber Mme Goodleaf avec une sorte de fatalisme douloureux.
Pour résister à tout ce stress, la psy pratique différents sports. Si elle a abandonné la chasse par empathie pour les animaux, elle continue de s’adonner à la pêche. Mais surtout, elle rame! Membre de l’équipe senior canadienne de bateaux-dragons, Suzy Goodleaf a participé à des compétitions l’été dernier en Chine, d’où son équipe est revenue avec deux médailles d’or. Depuis ce temps, un petit bouddha de jade trône sous le capteur de rêves, parmi sa pharmacie.
Se réjouissant que l’histoire des Premières Nations fasse l’objet d’un intérêt croissant dans l’ensemble de la population, Suzy Goodleaf avoue cependant craindre que celle-ci ne fasse l’objet d’usurpation et de pillage, « parce que beaucoup de nos traditions culturelles se sont transmises oralement ».
Elle conclut : « Nous sommes dans un processus de guérison. Pour l’instant, on remarque encore beaucoup de souffrance de l’âme, du corps et de l’esprit. Mais selon les prophéties des Anciens, nous allons finir par retrouver notre place! Je le vois. Ça s’en vient. »
Yves Gros-Louis | Psychologue

« Consulter un psy, c’est bien, mais il ne s’agit que d’un outil parmi tant d’autres. Chez les Premières Nations, le véritable processus de guérison ne fait que débuter », clame Yves Gros-Louis.
Membre des Premières Nations, spécialisé dans les problèmes de drogue et d’alcool, Yves Gros-Louis est psychologue, formateur et conférencier depuis plus de 30 ans. Il est né dans la réserve huronne de Wendake, à Loretteville, dans la région de la Capitale-Nationale. Diplômé de l’Université Laval, il a œuvré pendant plus de 12 ans dans cinq centres publics de réadaptation en toxicomanie à travers le Québec, en plus d’intervenir dans un centre pour personnes handicapées.
Jeune étudiant, il n’aurait jamais songé à œuvrer auprès des siens. « J’étais roux, je n’avais pas l’air d’un Autochtone et comme j’avais fait l’objet de racisme dans ma jeunesse, je ne m’en vantais surtout pas. Je n’avais pas été élevé dans la fierté. Mon identité, ma culture, je préférais oublier tout ça. »
Pourtant, au milieu des années 1990, il revient s’installer à Wendake. Seul psychologue de la région qui soit issu des Premières Nations, il reçoit une clientèle qui provient des réserves de l’ensemble du territoire. Il se souvient d’une vieille dame qui lui avait raconté comment elle se faisait agresser sexuellement par le prêtre toutes les semaines au moment de la confession. Désormais, il s’intéresse aux problèmes de ses frères et sœurs des régions éloignées. Il écoute leurs paroles à peine murmurées, issues d’une mémoire trop longtemps réprimée.
Mais qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis? « La crise d’Oka, affirme-t-il. Un sentiment de fierté est apparu qui a embrasé toutes les communautés autochtones. À ce regain culturel s’est ajouté un intérêt pour préserver la langue. Tout à coup, je n’avais plus honte. Je revendiquais l’histoire des Premières Nations comme étant la mienne. »
Yves Gros-Louis est reconnu pour sa patience et son calme. Invité à prononcer des allocutions un peu partout au Canada, il insiste sur le temps nécessaire pour compléter le processus de réparation déclenché par la Commission de vérité et réconciliation. « Ça va encore prendre une ou deux générations pour que les gens puissent s’en remettre », dit-il.
Il a bon espoir que les Communautés finissent par se prendre en main. « De plus en plus de jeunes deviennent intervenants. Ils partent dans le bois, s’initient aux rites et cérémonies traditionnelles, intègrent cette expérience à leur pratique. C’est juste un début. J’entends toutes sortes de belles histoires. »
Pour lutter contre les préjugés et le racisme, il ne voit pas trente-six solutions. « Je pense qu’il faudrait nous inclure dans l’histoire de ce pays, aux côtés des Français, des Européens. Ça en vaudrait la peine. L’expérience autochtone mérite d’être connue. »
À un Québécois francophone qui voudrait offrir ses services ou qui obtiendrait un poste de psychologue auprès des populations des Premières Nations, il offre les conseils suivants :
- Se montrer ouvert vis-à-vis des stratégies traditionnelles. S’initier à la culture, à l’histoire des Premières Nations.
- Rester conscient que certaines communautés au Québec ne parlent pas le français, mais s’expriment en anglais — c’est le cas des Cris en Abitibi et dans le Nord-du-Québec.
- Démontrer son respect envers la culture des Premières Nations.
- S’assurer que le client soit à l’aise. Réaliser que certaines personnes, chez les Attikameks par exemple, ont du mal à surmonter leur méfiance ou leur timidité. Faire les gestes qui rassurent, qui témoignent d’un respect sans cesse renouvelé.
Dr Joseph Beltempo | Psychologue

Né en Italie, le Dr Joseph Beltempo a grandi dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. Détenteur d’un diplôme en psychologie de l’Université McGill, il a complété ses études de maîtrise et de doctorat à l’Université de Montréal. En principe, rien ne le destinait à passer l’essentiel de sa carrière, comme psychologue clinicien, au Centre communautaire Shakotiia'takenhas de Kahnawake.
Il a à peine 30 ans lorsqu’il met les pieds dans la réserve pour la première fois. C’était en 1982. Seul Blanc ou presque parmi l’équipe de travailleurs sociaux du Centre, il aurait pu se sentir dépaysé. À son étonnement, c’est le contraire qui se produit. « Dans l’ensemble, cette société matriarcale me rappelait ma culture italienne. Non seulement j’ai été bien accueilli, mais on a beaucoup valorisé mon travail. J’ai eu une carrière extraordinaire. »
Professeur adjoint au département de Psychologie de l’université Concordia, il a intégré dans son enseignement la plupart des rites thérapeutiques pratiqués par les Premières Nations.
Il me conduit au pied de la sculpture « The Emergence of the Chief » érigée en 2005 dans la cour de l’ancien collège Loyola (l’édifice des Jésuites fait maintenant partie du campus de l’Université Concordia). Rue Sherbrooke Ouest, l’oeuvre de bronze montre une mère de clan intronisant un jeune chef iroquois. Elle est signée Dave McGary, sculpteur renommé de scènes de la vie amérindienne en Amérique du Nord, dont les oeuvres sont présentes dans les grandes collections du continent y compris celle de la Maison-Blanche.

La sculpture « The Emergence of the Chief » de l'artiste Dave McGary
Photo : Université Concordia
M. Beltempo me décline la signification de quelques symboles dans cette scène représentant la passation des pouvoirs chez les tribus iroquoises des Longues maisons. Il y a d’abord les nombreux symboles floraux, parmi lesquels on note les fleurs de fraisiers emblème de la nation mohawk. Les deux rangées de perles de la ceinture de wampum que tient le personnage féminin dans ses mains symbolisent la paix entre les peuples évoluant sur canot (Premières Nations) et ceux qui ont accosté en ces terres sur trois mats c’est-à-dire les Européens. La base de la sculpture représente une carapace de tortue, animal totem du clan du chef de présenté ici. Peu visible de la rue, cette oeuvre est à voir dit M. Beltempo, pour quiconque s’intéresse à la culture des Premières Nations.
« Ce que j’ai appris en côtoyant les Mohawks, dit M. Beltempo, c’est que nous, les psychologues, faisons partie d’un ensemble. Nous occupons l’intérieur d’un cercle de médecine. Même si notre rôle est essentiel, il ne nous permet pas d’assujettir quiconque.»
Au début des années 1980, il existait assez peu d’études sur le suicide, la dépression multi générationnelle ou même l’influence de l’abus d’alcool et des drogues sur la santé mentale. « Au début, j’avais des cas extrêmement difficiles. Malgré tout ce que j’avais assimilé comme connaissances, j’étais totalement dépassé.» Il s’est alors rappelé des recherches qu’il avait effectuées sous la direction du Dr John Sigal du Département de psychiatrie de l’Hôpital juif à Montréal. En échangeant avec son mentor, il a constaté les similitudes entre les symptômes observés chez les survivants de l’Holocauste et ceux de ses nouveaux patients. « J’ai réalisé également l’importance de la famille dans les deux cas. Ça m’a permis de cheminer pendant un moment. »
Puis la crise d’Oka a éclaté. L’affrontement a lieu suite à la décision de la municipalité d’Oka d’agrandir le golf municipal sur des terres en litige où se trouve un cimetière amérindien. Les Mohawks se rebiffent. Les militants décident de bloquer les routes du secteur. Un policier est tué. À la suite de quoi, l’armée canadienne intervient.
Du 11 juillet au 26 septembre 1990, le Dr Beltemppo parvient à franchir les barricades presque tous les jours. Il se rend compte que son emploi ne consistera jamais à demeurer passif derrière un bureau. « C’était mes clients. Je n’allais pas les abandonner. Je leur apportais de la nourriture. D’une certaine façon, j’allais travailler.» Oka a tout changé. « Il y a eu un éveil extraordinaire. Partout au Canada, les Autochtones ont pris la mesure de leur pouvoir. Désormais, plus personne ne les forcerait à céder leur territoire. »
Pour le Dr Beltempo, la crise marque également un tournant. Grâce à une généreuse subvention du gouvernement fédéral, il entreprend un projet de recherche sur les répercussions de la crise sur les communautés mohawks. Pendant deux ans, il visite chaque maison, enregistre chaque réaction.
Le Dr Beltempo aperçoit alors le monstre qui se profile derrière les taux effarants de suicide, de diabète et de violence familiale. « Ce qu’il y a derrière tout ça se résume en un mot, déclare-t-il : Oppression. Car si le colonialisme est basé sur l’exploitation des peuples, ses conséquences ont des effets là où ça fait le plus mal : dans la famille. »