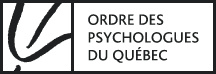La sexualité des couples à l’ombre des traumas interpersonnels subis durant l’enfance

La Dre Bigras est directrice du laboratoire de recherche sur les relations, la sexualité et les traumas (Reset) de l’Université du Québec en Outaouais. Par ses travaux, elle vise à éclaircir les liens entre les traumas interpersonnels à l’enfance et le bien-être sexuel des couples au quotidien et dans le temps.

Directrice du laboratoire de recherche de la vie sexuelle et intime (Sail Lab) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les travaux de la Dre Marie-Pier Vaillancourt-Morel portent sur la sexualité des couples. Elle est également professeure de psychologie à l’UQTR et chercheure régulière au sein du CRIPCAS et de l’équipe SCOUP.

Détentrice d’un doctorat en psychologie et d’un post-doctorat en psychiatrie et sciences du comportement, Mme Godbout est professeure titulaire au Département de sexologie de l’UQAM, directrice de l’unité de recherche et d’intervention sur les traumas et le couple (TRACE) et est spécialiste des impacts psychorelationnels des traumas interpersonnels à l’âge adulte.
Jouir d’une sexualité épanouissante et respectueuse est une aspiration commune à de nombreuses personnes. Pour y parvenir, plusieurs facteurs intra et interpersonnels doivent être présents. Par exemple, des représentations positives de soi et des autres, une bonne régulation des émotions ou encore une disposition à la présence attentive (Bigras et al., 2017; Leavitt et al., 2019; Godboutet al., 2024) aident à tolérer la proximité et la vulnérabilité inhérentes à une sexualité avec un ou une partenaire (Rosen et Bergeron, 2019; Vaillancourt-Morel et al., 2019). Plusieurs facteurs proximaux et distaux peuvent toutefois nuire au développement de ces habiletés, tels que l’expérience de traumas interpersonnels durant l’enfance (TIE) (Briere, 2002).
Traumas interpersonnels et répercussions sexuelles
La recherche a traditionnellement documenté les liens entre l’agression sexuelle durant l’enfance et la sexualité (Bigras et al., 2021), ignorant les autres TIE, qui peuvent survenir aussi dans des relations d’attachement, par exemple auprès de donneurs de soins. À priori, le lien entre les différents types de traumas non sexuels, comme la violence physique ou psychologique, la négligence physique ou psychologique, le fait d’être témoin de violence parentale ou même l’intimidation (Bernstein et al., 2003; Godbout et al., 2017), et la sexualité peut ne pas paraître évident. Or, ces expériences précoces de trahison ou de dévalorisation peuvent affecter le développement d’habiletés nécessaires à l’établissement de relations interpersonnelles stables et satisfaisantes (Bernstein et Freyd, 2014). En effet, les TIE peuvent amener la personne à douter d’elle-même, de l’amour qu’elle mérite, de la légitimité de ses besoins, mais aussi de la disponibilité de son ou sa partenaire et de sa capacité à répondre à ses besoins. Cela peut aussi conduire à un sens identitaire diffus et à des habiletés de régulation émotionnelle dysfonctionnelles (Briere, 2002) qui nuisent, en retour, à la sexualité.
Les études démontrent que le cumul de différents types de traumas est lié à une sexualité moins satisfaisante, à une moins bonne fonction sexuelle et à une plus grande détresse sexuelle chez les victimes, et ce, tant au sein d’échantillons d’adultes que de couples (Bigras et al., 2017a; Bigras et al., 2017b; Rellini et al., 2012; Vaillancourt-Morel et al., 2019; 2020; 2021). Des variables intermédiaires, comme les symptômes dépressifs ou les difficultés avec l’intimité, expliqueraient en partie ces liens (O’Loughlin et al., 2020; Vaillancourt-Morel et al., 2019). Toutefois, la plupart des études sur la sexualité se sont concentrées sur les conséquences individuelles des TIE (les effets des TIE d’une personne sur sa propre sexualité), révélant des tailles d’effet faibles sur les indicateurs de sexualité tels que la satisfaction sexuelle ou le désir (Bigras et al., 2017; O’Loughlin et al., 2020). Cela suggère que d’autres facteurs doivent être considérés et que toutes les victimes ne rapporteront pas ces répercussions.
Il est crucial de considérer les effets systémiques des TIE sur la sexualité des couples. Les modèles théoriques, les méta-analyses et les revues de la littérature suggèrent que les TIE d’une personne peuvent également affecter son ou sa partenaire (Bergeron et al., 2022; Vaillancourt-Morel et al., 2024). En effet, selon le modèle d’adaptation du couple au stress traumatique (Smith et Goff, 2005), les TIE peuvent mener à
- (a) des symptômes chez la victime;
- (b) des symptômes secondaires chez le ou la partenaire;
- (c) une dynamique dysfonctionnelle au sein du couple, se manifestant notamment dans la sexualité.
Des travaux menés auprès de couples hétérosexuels révèlent que des niveaux plus élevés de TIE chez la femme sont associés à une plus faible satisfaction sexuelle chez le partenaire, mais les TIE chez l’homme ne sont pas liés à la satisfaction sexuelle de la partenaire (Vaillancourt-Morel et al., 2019). De façon similaire, en considérant différents types de traumas séparément, plus de négligence chez l’homme, tant émotionnelle que physique, est associée à plus de détresse sexuelle chez leur partenaire, mais pas à la fonction ni à la satisfaction de celle-ci. Aucun des cinq types de traumas évalués (agression sexuelle, violence physique et psychologique, négligence physique et psychologique) n’est associé à la trajectoire de satisfaction, de fonction et de détresse sexuelles du ou de la partenaire au cours d’une période d’un an (Vaillancourt-Morel et al., 2021). Chez des couples où la femme souffre de douleurs génito-pelviennes, lorsque la femme rapporte des niveaux élevés de TIE, le partenaire rapporte des niveaux plus faibles de sa propre fonction sexuelle, alors que les TIE des partenaires ne sont pas liés à la fonction sexuelle de la femme (Corsini-Munt et al., 2017). Ces résultats prometteurs, mais limités aux couples hétérosexuels, soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur les effets dyadiques des TIE pour établir des leviers thérapeutiques efficaces afin d’offrir à ces couples des interventions adaptées qui tiendraient compte à la fois des effets des TIE sur la personne les ayant vécus, mais aussi sur sa ou son partenaire qui, par l’entremise du processus de traumatisation secondaire, pourrait aussi être affecté par ces TIE.
Quand le trauma s’immisce au cœur de l’intervention
Pour bien comprendre les difficultés de la personne, une évaluation approfondie de l’historique familial et développemental est indispensable, y compris des TIE. Cette dernière s’effectue lors des premières séances d’évaluation au moyen de questions directes sur les relations familiales et peut être bonifiée par des questionnaires validés à propos des TIE. Considérant les blessures relationnelles que peuvent causer les TIE, leurs risques de retentir en psychothérapie et de s’actualiser dans la relation thérapeutique sont grands. Dans ce contexte, la patience et le respect du rythme de la personne, tout comme l’observation des détails verbaux et non verbaux évoquant la répétition des relations d’objet du passé, des contradictions évoquant les conflits du monde interne ou encore des réactions post-traumatiques sont à préconiser. Les couples peuvent initier une demande d’aide pour des motifs sexuels, mais il est fréquent que des enjeux relationnels plus profonds émergent, tels qu’un bris de confiance ou des comportements violents. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de traiter ces enjeux avant d’aborder directement les questions sexuelles.
Les croyances et les stratégies de régulation émotionnelle dysfonctionnelles résultant des TIE peuvent nuire à la capacité de se sentir en sécurité dans la sexualité ou à ressentir du désir sexuel, créant décalages et ressentiment entre les partenaires, et devenir un motif de consultation en thérapie conjugale (Péloquin et al., 2019). Éviter la sexualité ou y recourir de manière compulsive sont aussi des résultantes possibles à la suite de TIE. Il est crucial de comprendre les peurs et les besoins sous-jacents à ces comportements afin d’en favoriser la mentalisation et, si tel est le souhait, le partage à l’autre dans le but d’instaurer ou de restaurer l’intimité et la connexion entre les partenaires.
À ce jour, il n’y a pas de thérapie conjugale spécifique validée pour répondre aux besoins des couples qui ont vécu des TIE et qui rapportent des difficultés sur le plan sexuel. Des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles peuvent même réagir moins bien aux thérapies existantes (Charbonneau-Lefebvre et al., 2022). Cela dit, les psychologues sont invités à adopter des pratiques sensibles aux traumas, à être vigilants à la réactivation d’enjeux relationnels, à intervenir avec tact, sensibilité et patience et à user des ressentis transférentiels et contre-transférentiels qui émergent en séance comme des outils puissants pour la guérison relationnelle et l’atteinte du bien-être sexuel.
En somme, le message à retenir est d’être à l’affût des expériences de TIE dans l’histoire biographique des clientes et des clients, qu’il s’agisse de TIE sexuels ou non, comme potentiels déterminants d’une sexualité moins satisfaisante ou générant plus de détresse, et ce, autant pour la personne qui les a subis que pour sa ou son partenaire. Des approches sensibles au trauma et axées sur la dynamique conjugale, qui permettent un apprivoisement de l’intimité et de la proximité à l’autre, une meilleure capacité à communiquer ses préférences sexuelles ainsi que le développement d’une vision positive de soi, sont à préconiser par les psychologues afin de permettre à ces couples d’expérimenter une sexualité, non pas exempte de défis, mais, à tout le moins, plus positive.
Bibliographie
- Bergeron, S., Bigras, N. et Vaillancourt-Morel, M. P. (2022). Child maltreatment and couples’ sexual health: A systematic review. Sexual Medicine Reviews, 10(4), 567-582.
- Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., Stokes, J., Handelsman, L., Medrano, M., Desmond, D. et Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. Child Abuse & Neglect, 27(2), 169-190.
- Bernstein, R. E. et Freyd, J. J. (2014). Trauma at home: How betrayal trauma and attachment theories understand the human response to abuse by an attachment figure. Attachment: New directions in psychotherapy and relational psychoanalysis, 8, 18-41.
- Bigras, N., Daspe, M. E., Godbout, N., Briere, J. et Sabourin, S. (2017). Cumulative childhood trauma and adult sexual satisfaction: Mediation by affect dysregulation and sexual anxiety in men and women. Journal of Sex and Marital Therapy, 1-20.
- Bigras, N., Vaillancourt-Morel, M.-P., Nolin, M.-C. et Bergeron, S. (2021). Associations between childhood sexual abuse and sexual well-being in adulthood: A systematic literature review. Journal of Child Sexual Abuse, 30(3), 332-352.
- Charbonneau-Lefebvre, V., Vaillancourt-Morel, M.-P., Rosen, N. O., Steben, M. et Bergeron, S. (2022). Attachment and childhood maltreatment as moderators of treatment outcome in a randomized clinical trial for provoked vestibulodynia. The Journal of Sexual Medicine, 19(3), 479-495.
- Godbout, N., Bigras, N. et Sabourin, S. (2017). Childhood cumulative trauma questionnaire (CCTQ) [manuscrit non publié]. Département de sexologie, Université du Québec à Montréal.
- Godbout, N., Lussier, Y. et Sabourin, S. (2006). Early abuse experiences and subsequent gender differences in couple adjustment. Violence and Victims, 21(6), 744-760.
- Godbout, N., Martel, N. W., Gewirtz-Meydan, A., Girard, M. et Hébert, M. (2024). When sexual distress shares the bed: The role of sexual self-esteem in the relationship between dispositional mindfulness and sexual distress in sex therapy patients. The Journal of Sexual Medicine, 21(10), 951-960.
- Leavitt, C. E., Lefkowitz, E. S. et Waterman, E. A. (2019). The role of sexual mindfulness in sexual wellbeing, relational wellbeing, and self-esteem. Journal of Sex and Marital Therapy, 45(6), 497-509.
- O’Loughlin, J. I., Rellini, A. H. et Brotto, L. A. (2020). How does childhood trauma impact women’s sexual desire? Role of depression, stress, and cortisol. The Journal of Sex Research, 57(7), 836-847.
- Péloquin, K., Byers, E. S., Callaci, M. et Tremblay, N. (2019). Sexual portrait of couples seeking relationship therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 45(1), 120-133.
- Rosen, N. O. et Bergeron, S. (2019). Genito-pelvic pain through a dyadic lens: Moving toward an interpersonal emotion regulation model of women’s sexual dysfunction. Journal of Sex Research, 56(4-5), 440-461.
- Vaillancourt-Morel, M. P., Rellini, A. H., Godbout, N., Sabourin, S. et Bergeron, S. (2019). Intimacy mediates the relation between maltreatment in childhood and sexual and relationship satisfaction in adulthood: A dyadic longitudinal analysis. Archives of Sexual Behavior, 48(3), 803-814.
- Vaillancourt-Morel, M. P., Byers, E. S., Péloquin, K. et Bergeron, S. (2021). A dyadic longitudinal study of child maltreatment and sexual well-being in adult couples: The buffering effect of a satisfying relationship. Journal of Sex Research, 58(2), 248-260.
- Vaillancourt-Morel, M.-P., Bussières, È.-L., Nolin, M.-C. et Daspe, M.-È. (2024). Partner effects of childhood maltreatment: A systematic review and meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 25(2), 1150-1167.