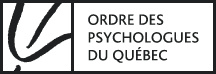Claude Bélanger – « Connaître pour mieux combattre, évaluer pour mieux ressentir et agir »
André Lavoie, journaliste

Photo : Louis-Étienne Doré
Au début de l’âge adulte, Claude Bélanger rêvait de devenir biologiste et avait développé une véritable passion… pour la vie marine. Difficile à croire quand on connaît ce psychologue pour ses recherches sur les troubles anxieux, son implication pour la mise en place du Centre de services psychologiques (CSP) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ou encore la fondation du tout premier programme universitaire de psychologie à Madagascar.
Pendant ses études collégiales au Campus Notre-Dame-de-Foy, en banlieue de Québec, Claude Bélanger se joint à un club d’aquariophilie, d’où émerge sa fascination pour la vie aquatique — un univers où la recherche et le maintien d’un subtil équilibre permettent à chaque organisme, avec ses besoins propres, de s’épanouir. Sous la supervision du frère Laganière, enseignant en biologie et mentor, Claude Bélanger croit avoir trouvé dans ce laboratoire sa vocation, entouré d ’une quarantaine d ’aquariums. Ce professeur très inspirant avait développé, dès la fin des années 1960, un intérêt précoce pour l’écologie, et offrait à ses étudiants la chance de donner des conférences scientifiques.
Or, de la biologie marine à la psychologie, il n’y avait qu’un pas, qu’a franchi Claude Bélanger lors d’un cours d’introduction qui allait cristalliser son choix de carrière. « Je voulais comprendre les mécanismes de la vie, mais j’ai vite réalisé que l’être humain est d’une complexité beaucoup plus grande qu'elle ne l'est chez les poissons », lance Claude Bélanger sur un ton amusé alors qu’il nous accueille dans son bureau ensoleillé du Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, rue Sherbrooke. Ce natif de Grand-Mère a dès lors trouvé sa véritable passion. Il entame des études à l’Université d’Ottawa, où il obtient en 1977 une maîtrise en psychologie.
C’est à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, à Verdun, que le jeune clinicien fait ses premiers pas professionnels. Il y réalise à quel point l’anxiété constitue un point commun entre les difficultés de diverses personnes pouvant tout aussi bien souffrir de dépression, de troubles de personnalité ou de problèmes conjugaux. Dans un esprit collaboratif, Claude Bélanger met en place une équipe multidisciplinaire pour traiter les individus aux prises avec divers défis et enjeux psychologiques les freinant dans leur épanouissement.
À l’aube de la quarantaine, Claude Bélanger, père de famille qui mène sa carrière tambour battant, entreprend un doctorat en psychologie à l’Université de Montréal. Il l’achèvera en un temps record, une rapidité qu’il explique par sa discipline de fer : éviter toute distraction inutile et chronophage.
Changer le monde, un projet à la fois
En entrant à l’UQAM en 1996, Claude Bélanger découvre une nouvelle passion, celle de l’enseignement, tout en continuant à multiplier les projets destinés à améliorer l’encadrement des étudiants et à élargir les bienfaits de la psychologie chez les populations les plus vulnérables.
Avec fierté, il se rappelle aujourd’hui les débuts modestes du CSP de l’UQAM, un projet impressionnant dont il fut l’instigateur et le premier directeur. Chaque année, plus de 60 étudiants en psychologie y font leurs premières armes avec l’appui de nombreux superviseurs, accompagnant près de 500 patients pendant environ 15 rencontres, et ce, à des coûts permettant aux étudiants et aux citoyens les moins fortunés d’avoir accès à des ressources psychologiques qu’ils ne pourraient pas obtenir autrement.
Selon Claude Bélanger, la création de ce lieu précieux offrant des stages répondait à une demande récurrente des milieux professionnels, où les doctorants sont qualifiés de « trop verts » lorsqu’ils débarquent dans leur premier milieu d'internat. Ce n’est plus le cas grâce à cet endroit unique qui fait une fois de plus la réputation du « plus gros Département de psychologie d’Amérique du Nord », déclare le professeur de l’UQAM.
Repousser les frontières jusqu’en Afrique
Au milieu des années 2000, une autre grande aventure attend le psychologue-chercheur, qui ignore tout d’abord qu’elle le conduira aussi loin que Madagascar, cette grande île située au large de la côte sud-est du continent africain. Sa population, qui compte maintenant plus de 30 millions d’habitants, n’avait pas accès à l’époque aux services de psychologues, et les universités malgaches n’en formaient pas. Devant cette situation déplorable, une religieuse missionnaire avait alerté son frère, vice-recteur de l’Université de Sherbrooke, qui avait lancé à la communauté universitaire un appel à la solidarité. C’est alors que Claude Bélanger lève la main pour apporter son soutien à ce pays africain et, éventuellement, s’y rendre. Il allait ainsi jeter les bases du tout premier département universitaire de psychologie de Madagascar.
« Les médecins de famille faisaient tout leur possible, de même que les intervenants psychosociaux, mais les problèmes d’anxiété, d’alcoolisme et de dépression liés à la pauvreté étaient et sont encore nombreux », se souvient Claude Bélanger. Petit à petit, le baccalauréat, la maîtrise et maintenant un tout nouveau programme de doctorat prennent forme, alors que l’équipe accompagne les toutes premières cohortes d’étudiants grâce au dévouement de plusieurs professeurs québécois qui donnent des cours, corrigent des mémoires, participent à des comités de soutenance de thèses, etc. « Un peu comme le gouvernement durant la pandémie, nous avons dû construire l’avion en plein vol », se remémore Claude Bélanger.
Or, à son grand bonheur, l ’appareil file à vive allure, sans compter le projet d’instaurer un doctorat pour former des professeurs qui prendront ensuite en charge la formation des étudiants malgaches. « D’ailleurs, la relève professorale se met déjà en place, puisque tous les cours du baccalauréat sont maintenant assumés par de jeunes psychologues malgaches, nouvellement formés. » Claude Bélanger ne cache pas non plus sa fierté de savoir que « tous les diplômés ont trouvé du travail ».
Quant à lui, il sait que beaucoup de choses vont lui manquer au moment de mettre un terme à sa carrière. La pratique de l’enseignement n’est pas la moindre. Ses échanges avec les étudiants n’ont jamais cessé de l’inspirer. « Ils sont allumés, posent de bonnes questions, soulèvent de bonnes controverses. »
Mais, à 73 ans, et après avoir subi des ennuis de santé qui l’ont tenu un temps éloigné de ses fonctions, Claude Bélanger s’achemine tranquillement vers la retraite, fier de ses réalisations. Sa posture actuelle reflète d’ailleurs ce qu’il avait écrit dans un livre grand public intitulé Stress et anxiété : votre guide de survie (La semaine, 2008) : « Si nous ne sommes pas toujours responsables des événements qui surviennent dans notre vie, nous pouvons toujours intervenir dans notre façon d’appréhender ces événements et dans l’attitude que nous adoptons à leur égard. [En somme], connaître pour mieux combattre, évaluer pour mieux ressentir et agir. »
À traits levés
1. Un livre marquant :
L'écume des jours, de Boris Vian.
2. Un film émouvant :
Hidden Figures, de Theodore Melfi.
3. Si je n'étais pas psychologue, je serais... :
Biologiste marin.
4. Un mot qui résumerait mon parcours professionnel :
La passion!
5. Ma plus grande fierté :
Le développement du département de psychologie à Madagascar et la mise sur pied du CSP de l'UQAM.