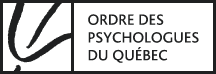Dre Julie Ménard, psychologue – Le monde du travail : modes d’emploi et mutations
André Lavoie, journaliste

Photo : Louis-Étienne Doré
Ce n’est pas donné à tous de découvrir avec certitude, dès l’âge de 14 ans, la profession que l’on exercera plus tard. C’est pourtant arrivé à Julie Ménard. Non seulement elle savait qu’elle voulait devenir psychologue, mais elle avait déjà aussi choisi son domaine de pratique : le monde du travail et des organisations. Cette révélation peu commune, elle la doit à son père, employé d’une grande organisation souhaitant gravir les échelons et devenir gestionnaire. Il avait raconté à sa fille sa longue journée d’évaluation du potentiel au moyen de tests et de jeux de rôle lors de son embauche ; encore adolescente, celle-ci avait bu ses paroles. « J’aimais faire du théâtre, alors l’idée d’organiser des jeux de rôle, des mises en situation, ça me plaisait beaucoup », dit-elle, amusée. Rapidement, sa trajectoire scolaire s’est construite autour de cette ambition, la menant au baccalauréat en psychologie, et au doctorat à l’Université de Montréal, puis à City St-George’s, University of London pour ses études postdoctorales en psychologie du travail et des organisations. À cette époque, son superviseur d’internat était Jean-Pierre Lanthier, « un des psychologues les plus respectés dans ce domaine », précise Julie Ménard, celui-là même qui avait jadis soumis son père à une batterie de tests! « Il a appris la coïncidence assez rapidement », se souvient celle qui est aujourd’hui professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Depuis plus de quinze ans, elle observe avec fascination les mutations du monde du travail, animée par le désir profond de mieux comprendre le fonctionnement humain, mais aussi – et surtout – par la volonté de préserver la santé psychologique des travailleurs.
Pour beaucoup de personnes, le travail constitue une part essentielle de l’identité. Dans ce contexte, quelle place accordons-nous, au Québec, à l’identité professionnelle et à la hiérarchie au sein des organisations?
Selon notre milieu, notre éducation et nos valeurs, notre emploi et les titres qui y sont accolés possèdent une importance différente. Même si le Québec s’est distancié de l’Église catholique depuis les années 1960, certaines valeurs d’humilité persistent, dont l’identité au travail. Comparativement à d’autres sociétés, nous sommes plus ou moins préoccupés par la hiérarchie, davantage inclusifs et équitables.
Quels sont les principaux facteurs risquant d’affecter la santé physique et psychologique des travailleurs?
Notre emploi a certainement un impact sur notre santé physique et psychologique, selon bien sûr ce que nous faisons, et dans quel contexte. On attribue souvent le mal-être au travail à un manque de reconnaissance, mais ce n’est pas tout. La CNESST a identifié d’autres facteurs comme l’autonomie, le soutien, le sentiment de justice et la charge de travail. Par exemple, si des employés considèrent que leur gestionnaire souligne davantage les bons coups de certains collègues plutôt que d’autres, ça peut vite créer un sentiment d’injustice.
Lorsqu’un emploi procure peu ou pas de reconnaissance, vaut-il mieux aller chercher cette valorisation ailleurs ou tenter d’améliorer la situation au sein de l’organisation?
C’est sain de trouver d’autres formes de valorisation si cette dimension se révèle absente de notre travail. Parfois, il y a des emplois qui ne sont pas valorisants, et si on peut trouver mieux, il faut foncer! Ce qui ne veut pas dire que les gestionnaires ne doivent rien faire pour les travailleurs, bien au contraire. La reconnaissance, c’est prendre le temps de voir l’autre, tout simplement, sans pour autant sortir les ballons ou attendre qu’un employé prenne sa retraite pour lui offrir une montre. De toute façon, les gens ne restent maintenant que quelques années dans les organisations. Quant aux gestionnaires, on les encourage à cultiver la reconnaissance au quotidien, mais beaucoup de choses reposent sur leurs épaules de sorte qu’il leur est parfois difficile de relever la tête et de prendre le temps. Et rappelons-nous qu’eux aussi ont besoin de reconnaissance.
Sans compter qu’ils doivent gérer un milieu de travail sans cesse bouleversé par les transformations sociales et les développements technologiques. Peut-on envisager ces mutations – notamment l’avènement de l’intelligence artificielle – avec optimisme? Et comment composer avec les autres innovations qui modifient nos façons de travailler?
J’essaie d’avoir une boule de cristal, j’y réfléchis, mais j’ai du mal à me positionner sur les enjeux et les questions entourant l’IA, même si je sais très bien que cela va bouleverser le monde du travail. J’évite de ressembler à tous ces gens qui nous avaient jadis promis la société des loisirs! [Rires] Plus sérieusement, l’IA pourrait proposer deux avenues : un nouveau modèle économique et une réelle diminution des heures de travail, ou alors, comme on a pu le voir dans le passé, on presse le citron des travailleurs avec des attentes différentes sur le temps passé au travail.
Voyez d’ailleurs comment les nouvelles technologies ont accéléré le phénomène du blurring, rendant la frontière de plus en plus poreuse entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec les courriels et les téléphones intelligents. Qui aurait pu imaginer que cet outil allait nous absorber pendant des heures, alors qu’à côté de nous des gens ont soif de contacts sociaux, et en sont privés? Tout cela suscite beaucoup de questions, beaucoup d’insécurité, et pour les jeunes générations, vous pouvez ajouter à cela la hausse du coût de la vie. Quand je regarde la nouvelle génération cependant, j’ai espoir qu’on trouvera une façon de composer avec cette vague d’IA qui s’en vient. Pas sans écueil bien sûr, mais j’ai espoir.
Certains chercheurs proposent d’intégrer l’épuisement professionnel au DSM. L’ajout d’un tel diagnostic représenterait-il un véritable progrès pour soutenir les travailleurs? Et comment comprendre les autres difficultés psychologiques liées au travail?
La Suède reconnaît l’épuisement professionnel, même si ce n’est pas une condition médicale, parce qu’on y utilise l’ICD-111 de l’Organisation mondiale de la santé qui, de son côté, reconnaît l’épuisement comme phénomène occupationnel. Et il faut dire que les pays du nord de l’Europe sont des précurseurs en ce qui concerne la santé psychologique. Chez nous, les personnes avec des symptômes d’épuisement recevront généralement un diagnostic, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive ou anxieuse. En plus des médecins, les psychologues ont maintenant le droit de poser des diagnostics reconnus, et c’est une avancée formidable : ils sont bien placés pour comprendre ce que vivent leurs clients. Sans compter que ce n’est pas tout le monde qui a facilement accès à un médecin. Mais ce que cette inclusion permettrait, c’est de reconnaître que le travail est la source du problème de certains individus, et de mettre ça en évidence sur la place publique. Ainsi, on comprendrait mieux le phénomène et, à mon avis, le sujet serait moins tabou. J’ai d’ailleurs bon espoir que cette inclusion finira par arriver.
De manière plus générale, avec la loi 27 [modernisant le régime de santé et de sécurité au travail depuis 2021], les organisations doivent tenir compte de la santé psychologique des travailleurs. Elles doivent agir, donner accès à des ressources, offrir des façons d’atténuer les risques psychosociaux. Par exemple, si quelqu’un est victime de violence à la maison et que le télétravail est possible, le gestionnaire de cette personne pourrait accepter qu’elle s’installe dans un café plutôt que dans sa demeure. La nouvelle loi incite non seulement à les identifier, mais aussi à les prévenir.
L’épuisement professionnel touche-t-il plus particulièrement certains types d’emplois ou de milieux, ou s’explique-t-il avant tout par des facteurs individuels et contextuels?
Il ne faut jamais oublier que ça dépend d’abord de la combinaison de l’individu et du cadre dans lequel il évolue. En psychologie du travail, une des théories que nous utilisons est celle de la conservation des ressources. L’être humain possède une tendance naturelle à vouloir conserver ses ressources, il ne veut pas s’en faire retirer. Lorsque surgit cette perte, le travailleur peut ressentir un stress plus ou moins grand, affectant ainsi sa santé psychologique. À l’opposé, prenez par exemple les enseignants en Finlande. La sélection est très rigoureuse, ils reçoivent un bon salaire, ils sont reconnus socialement parce que considérés comme de véritables experts, et le système est équitablement financé. Donc, plus vous avez des ressources pour bien faire rouler un système, plus vous avez de chance que ceux et celles qui y travaillent soient en bonne santé physique et mentale.
Le syndrome de l’imposteur semble de plus en plus évoqué dans les milieux professionnels. À quel point ce phénomène est-il répandu? Et quelles formes prend-il chez les professeurs d’université, que vous étudiez de près?
D’abord, arrêtons de croire qu’il s’agit d’un phénomène majoritairement féminin, car les études ne sont pas cohérentes sur ce point. Les femmes ont souvent été socialisées d’une façon qui fait en sorte qu’elles sont peut-être plus conscientes d’elles-mêmes, s’expriment davantage, contrairement aux hommes, à qui on accorde moins le droit de montrer une certaine vulnérabilité sur le plan social. Parler du syndrome de l’imposteur, c’est forcément aborder la question de l’ego, qui peut être plus présent chez les professeurs d’université, à cause de la nature de leur travail. Or, effectuer des recherches, publier, demander des subventions, accompagner des étudiants, tout cela fait en sorte qu’ils se transforment en PME… mais avec une reconnaissance somme toute minime. Car faire de la recherche, c’est le plus souvent un travail solitaire, loin des projecteurs, avec peu de rétroaction, même devant les étudiants. Surtout que l’enseignement n’occupe pas la plus grande part du temps de travail des professeurs. Ce que j’ai découvert, c’est que le syndrome de l’imposteur s’installe déjà chez les étudiants au doctorat, convaincus qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour poursuivre leurs études. Et pensez-vous que cette conviction disparaît une fois qu’ils deviennent professeurs?
Vous menez actuellement une étude sur le retour au travail après un congé parental. Quels constats se dégagent, jusqu’ici, concernant l’équilibre entre les identités parentale et professionnelle?
Nous recrutons encore des parents pour cette étude, et particulièrement des pères; une fois encore, les hommes sont trop peu nombreux. Ils sont aussi trop souvent absents des études en psychologie. Le but de cette recherche est d’offrir des stratégies aux parents pour prendre soin de leur santé psychologique au quotidien. Car deux identités se confrontent, parentale et professionnelle, de sorte qu’il est parfois difficile de concilier le nouveau rôle. Pour tout dire, les parents travailleurs se sentent souvent bien moyens dans chacun de leurs rôles, et c’est pourquoi nous visons à trouver des façons de combler leurs besoins psychologiques de base : développer son autonomie, ses compétences, cultiver l’importance de se connecter aux autres, etc. Nous n’avons en ce moment que des résultats préliminaires, mais nous souhaitons offrir aux parents des guides pour maintenir leur engagement professionnel au travail ainsi que leur santé psychologique dans leur vie en général.
À traits levés
1. Un livre marquant :
La femme qui fuit, d’Anaïs Barbeau-Lavalette
2. Une série télé marquante :
Empathie
3. Une personnalité inspirante :
Catherine Éthier
4. Un mot qui résumerait votre parcours :
Authenticité
5. Une phrase ou un proverbe qui vous définit ou qui vous donne de la motivation :
« Cordonnier bien chaussé! »
Note
- International Classification of Diseases (11e édition).